Nos projets en cours

Potentiel des bandes fleuries arborées pour améliorer la résilience des bourdons envers les changements climatiques au Québec
Étudiant : Kévin Matte; collaborateur : Marc J. Mazerolle (Université Laval)
Les changements climatiques ont des effets majeurs sur la biodiversité au Québec. Un de ces effets, la hausse des températures, pourrait être en cause dans le déclin marqué chez certains pollinisateurs comme les bourdons. Le projet vise à établir des stratégies d’aménagements pour améliorer la résilience des populations de bourdons sur les fermes. Cette étude permettra de mieux comprendre la capacité et le comportement des bourdons face à des hausses de températures en milieu naturel. Elle aidera aussi à mieux comprendre les effets positifs ou négatifs que le type d’environnement avoisinant peut apporter. Nous étudierons l'impact de la hausse des températures sur des colonies commerciales de bourdons placées dans des champs témoins, des bandes fleuries et des bandes fleuries avec des arbres. Finalement, les résultats permettront de conseiller des aménagements optimaux pour augmenter la résilience des colonies de bourdons en milieu agricole.
Étudiant : Kévin Matte; collaborateur : Marc J. Mazerolle (Université Laval)
Les changements climatiques ont des effets majeurs sur la biodiversité au Québec. Un de ces effets, la hausse des températures, pourrait être en cause dans le déclin marqué chez certains pollinisateurs comme les bourdons. Le projet vise à établir des stratégies d’aménagements pour améliorer la résilience des populations de bourdons sur les fermes. Cette étude permettra de mieux comprendre la capacité et le comportement des bourdons face à des hausses de températures en milieu naturel. Elle aidera aussi à mieux comprendre les effets positifs ou négatifs que le type d’environnement avoisinant peut apporter. Nous étudierons l'impact de la hausse des températures sur des colonies commerciales de bourdons placées dans des champs témoins, des bandes fleuries et des bandes fleuries avec des arbres. Finalement, les résultats permettront de conseiller des aménagements optimaux pour augmenter la résilience des colonies de bourdons en milieu agricole.

Quantifier l’exposition liée aux résidus de pesticides dans le pollen et le nectar de plantes sauvages et cultivées pour les pollinisateurs indigènes
Étudiant : Michaël Tremblay; collaboratrice : Sabrina Rondeau (University of Guelph, University of Ottawa)
Près de 90 % de toutes les espèces végétales, y compris 75 % des principales espèces cultivées pour notre alimentation, dépendent de la pollinisation animale pour se reproduire. Cependant, le déclin remarqué de ces pollinisateurs représente une menace pour la sécurité alimentaire ainsi que pour la biodiversité. L'intensification agricole et l'utilisation intensive de pesticides sont des facteurs majeurs contribuant à ce déclin. Les pollinisateurs sont exposés aux pesticides par le biais de différentes voies, notamment la consommation de pollen et de nectar contaminés. Ce projet vise à quantifier les résidus de pesticides dans le pollen et le nectar des fleurs sauvages en bordure de champs ainsi que de fleurs de différentes cultures pratiquées au Québec, soit de canneberges, de pommes et de courges. Ces données permettront d’évaluer la possibilité de prédire les concentrations de pesticides dans le nectar à partir de celles détectées dans le pollen, ce qui pourrait faciliter l'évaluation des risques pour les pollinisateurs. De plus, afin de minimiser leur exposition, une distance sécuritaire séparant le point d’application des pesticides et des plantes sauvages sera déterminée afin de guider les agriculteurs dans leurs pratiques culturales.
Étudiant : Michaël Tremblay; collaboratrice : Sabrina Rondeau (University of Guelph, University of Ottawa)
Près de 90 % de toutes les espèces végétales, y compris 75 % des principales espèces cultivées pour notre alimentation, dépendent de la pollinisation animale pour se reproduire. Cependant, le déclin remarqué de ces pollinisateurs représente une menace pour la sécurité alimentaire ainsi que pour la biodiversité. L'intensification agricole et l'utilisation intensive de pesticides sont des facteurs majeurs contribuant à ce déclin. Les pollinisateurs sont exposés aux pesticides par le biais de différentes voies, notamment la consommation de pollen et de nectar contaminés. Ce projet vise à quantifier les résidus de pesticides dans le pollen et le nectar des fleurs sauvages en bordure de champs ainsi que de fleurs de différentes cultures pratiquées au Québec, soit de canneberges, de pommes et de courges. Ces données permettront d’évaluer la possibilité de prédire les concentrations de pesticides dans le nectar à partir de celles détectées dans le pollen, ce qui pourrait faciliter l'évaluation des risques pour les pollinisateurs. De plus, afin de minimiser leur exposition, une distance sécuritaire séparant le point d’application des pesticides et des plantes sauvages sera déterminée afin de guider les agriculteurs dans leurs pratiques culturales.

Amélioration de la santé et de la nutrition des bourdons en milieu agricole : Optimisation des mélanges fleuris
Étudiante : Amélie Morin; collaboratrices : Mathilde Tissier (Centre National de la Recherche Scientifique) et Virginie Durand (UPA)
Au Canada, plusieurs espèces de bourdons sont en péril, ce qui engendre des préoccupations majeures pour la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes. Le maintien d’une alimentation de haute qualité nutritionnelle pour favoriser leur santé dans les écosystèmes agricoles est actuellement un défi majeur. Le projet se divise en trois sous-objectifs visant à 1) Caractériser les profils nutritifs et médicinaux de ressources florales consommées par les bourdons, 2) Identifier les carences nutritives des bourdons en péril au Québec, les contaminants et agents pathogènes les affectant, ainsi que les ressources florales qu’ils consomment, et 3) Identifier des mélanges nutritifs et médicinaux pour aménagements fleuris favorisant la santé et la reproduction des bourdons. Pour répondre à ces objectifs, nous évaluerons l’effet des pollens sur le comportement, la santé et les performances des bourdons. Nous établirons également un dispositif expérimental qui nous permettra de comparer l’effet de trois types de mélanges fleuris sur la santé, la performance et le comportement des bourdons. Les connaissances obtenues nous permettront d’émettre des recommandations précises visant à soutenir la reproduction des bourdons tout en améliorant leur état de santé global dans un objectif de conservation.
Étudiante : Amélie Morin; collaboratrices : Mathilde Tissier (Centre National de la Recherche Scientifique) et Virginie Durand (UPA)
Au Canada, plusieurs espèces de bourdons sont en péril, ce qui engendre des préoccupations majeures pour la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes. Le maintien d’une alimentation de haute qualité nutritionnelle pour favoriser leur santé dans les écosystèmes agricoles est actuellement un défi majeur. Le projet se divise en trois sous-objectifs visant à 1) Caractériser les profils nutritifs et médicinaux de ressources florales consommées par les bourdons, 2) Identifier les carences nutritives des bourdons en péril au Québec, les contaminants et agents pathogènes les affectant, ainsi que les ressources florales qu’ils consomment, et 3) Identifier des mélanges nutritifs et médicinaux pour aménagements fleuris favorisant la santé et la reproduction des bourdons. Pour répondre à ces objectifs, nous évaluerons l’effet des pollens sur le comportement, la santé et les performances des bourdons. Nous établirons également un dispositif expérimental qui nous permettra de comparer l’effet de trois types de mélanges fleuris sur la santé, la performance et le comportement des bourdons. Les connaissances obtenues nous permettront d’émettre des recommandations précises visant à soutenir la reproduction des bourdons tout en améliorant leur état de santé global dans un objectif de conservation.

Écologie des cicadelles dans les fraisières du Québec
Étudiante en codirection : Jordanne Jacques; chercheur principal : Edel Pérez-López (Université Laval)
Les changements climatiques ont un impact significatif sur l’agriculture et les insectes ravageurs. Les températures plus élevées modifient les aires de répartition des insectes, favorisent leur survie hivernale et accélèrent leur développement. Au Québec, l’augmentation des cicadelles dans les fraisières a entraîné une utilisation accrue de pesticides, ce qui est préoccupant pour l’industrie de la fraise et l’environnement. Ainsi, ce projet vise à étudier la diversité des cicadelles dans les fraisières québécoises, les effets des changements climatiques sur leur abondance et la présence de parasitoïdes qui leur sont associés. Les résultats permettront d’évaluer la diversité en genre des cicadelles dans les fraisières du Québec, de déterminer la corrélation entre des paramètres climatiques et leur abondance et d’identifier leurs ennemis naturels présents en fraisières. Les résultats de cette étude offriront des pistes pour une gestion plus durable de ces ravageurs dans les fraisières du Québec.
Étudiante en codirection : Jordanne Jacques; chercheur principal : Edel Pérez-López (Université Laval)
Les changements climatiques ont un impact significatif sur l’agriculture et les insectes ravageurs. Les températures plus élevées modifient les aires de répartition des insectes, favorisent leur survie hivernale et accélèrent leur développement. Au Québec, l’augmentation des cicadelles dans les fraisières a entraîné une utilisation accrue de pesticides, ce qui est préoccupant pour l’industrie de la fraise et l’environnement. Ainsi, ce projet vise à étudier la diversité des cicadelles dans les fraisières québécoises, les effets des changements climatiques sur leur abondance et la présence de parasitoïdes qui leur sont associés. Les résultats permettront d’évaluer la diversité en genre des cicadelles dans les fraisières du Québec, de déterminer la corrélation entre des paramètres climatiques et leur abondance et d’identifier leurs ennemis naturels présents en fraisières. Les résultats de cette étude offriront des pistes pour une gestion plus durable de ces ravageurs dans les fraisières du Québec.

Nichoirs artificiels et sites d'hivernage des bourdons dans les cultures fruitières du Québec
Étudiante : Lydia Millette-St-Hilaire; collaboratrice : Amélie Gervais
Les bourdons sont d’excellents pollinisateurs pour plusieurs cultures, dont les bleuets en corymbe, les canneberges et les pommes. Toutefois, leur survie est menacée par le manque de sites pour la nidification au printemps et l’hibernation à l’automne. Afin de participer à la conservation des bourdons, il est important d’en apprendre davantage sur ces deux phases déterminantes de leur cycle de vie, notamment sur l’habitat et les ressources artificielles utilisées. Cette étude augmentera les connaissances sur la nidification des bourdons en évaluant l’efficacité de nichoirs artificiels (en bois sous terre, en bois hors du sol, sous une plaque de béton ou dans un pot en terre cuite) installés sur des fermes de pommes, de bleuets en corymbe et de canneberges. En plus de permettre d’étudier les bourdons, les nichoirs ajoutent des sites de nidifications, qui sont peu nombreux en milieu agricole, participant ainsi à leur conservation. Le projet permettra également d’en apprendre davantage sur l’hibernation des bourdons en caractérisant les sites d’hibernation et la dispersion des bourdons à l’automne grâce à la télémétrie.
Étudiante : Lydia Millette-St-Hilaire; collaboratrice : Amélie Gervais
Les bourdons sont d’excellents pollinisateurs pour plusieurs cultures, dont les bleuets en corymbe, les canneberges et les pommes. Toutefois, leur survie est menacée par le manque de sites pour la nidification au printemps et l’hibernation à l’automne. Afin de participer à la conservation des bourdons, il est important d’en apprendre davantage sur ces deux phases déterminantes de leur cycle de vie, notamment sur l’habitat et les ressources artificielles utilisées. Cette étude augmentera les connaissances sur la nidification des bourdons en évaluant l’efficacité de nichoirs artificiels (en bois sous terre, en bois hors du sol, sous une plaque de béton ou dans un pot en terre cuite) installés sur des fermes de pommes, de bleuets en corymbe et de canneberges. En plus de permettre d’étudier les bourdons, les nichoirs ajoutent des sites de nidifications, qui sont peu nombreux en milieu agricole, participant ainsi à leur conservation. Le projet permettra également d’en apprendre davantage sur l’hibernation des bourdons en caractérisant les sites d’hibernation et la dispersion des bourdons à l’automne grâce à la télémétrie.

Méthodes de gestion des colonies commerciales de bourdons (Bombus impatiens) pour optimiser leur performance durant la pollinisation bleuet nain (Vaccinium angustifolium)
Étudiante en codirection : Anne-Charlie Robert; collaborateur : Pierre Giovenazzo (Université Laval)
L’importance des bourdons commerciaux (Bombus impatiens) augmente en agriculture, entre autres pour la production du bleuet nain (Vaccinium angustifolium), due à leur efficacité pour polliniser. Les méthodes encore méconnues de gestion des colonies commerciales de bourdons doivent être explorées afin de maximiser leur rendement en pollinisation du bleuet. Cette étude vise à déterminer quelles méthodes de gestion de l’ensoleillement et d’installation des colonies encouragent une plus forte activité de butinage et une meilleure santé des colonies. Des colonies de B. impatiens ont été installées à des moments différents dans une bleuetière de La Doré, au Lac-Saint-Jean. La moitié des colonies était protégée contre l’exposition au soleil et l’autre moitié n’était pas protégée. Les effets de ces méthodes seront rapportés sur l’activité des butineuses et la croissance et la santé des colonies. Ces résultats permettront d’optimiser la gestion des colonies commerciales de bourdons, ce qui permettra aux producteurs de bleuets de rentabiliser leur utilisation de bourdons dans leurs champs afin d’optimiser leur rendement.
Étudiante en codirection : Anne-Charlie Robert; collaborateur : Pierre Giovenazzo (Université Laval)
L’importance des bourdons commerciaux (Bombus impatiens) augmente en agriculture, entre autres pour la production du bleuet nain (Vaccinium angustifolium), due à leur efficacité pour polliniser. Les méthodes encore méconnues de gestion des colonies commerciales de bourdons doivent être explorées afin de maximiser leur rendement en pollinisation du bleuet. Cette étude vise à déterminer quelles méthodes de gestion de l’ensoleillement et d’installation des colonies encouragent une plus forte activité de butinage et une meilleure santé des colonies. Des colonies de B. impatiens ont été installées à des moments différents dans une bleuetière de La Doré, au Lac-Saint-Jean. La moitié des colonies était protégée contre l’exposition au soleil et l’autre moitié n’était pas protégée. Les effets de ces méthodes seront rapportés sur l’activité des butineuses et la croissance et la santé des colonies. Ces résultats permettront d’optimiser la gestion des colonies commerciales de bourdons, ce qui permettra aux producteurs de bleuets de rentabiliser leur utilisation de bourdons dans leurs champs afin d’optimiser leur rendement.

Évaluation de l’impact de la composition et de la structure de bandes fleuries aménagées en bord de champs comme outil pour la conservation des bourdons en Montérégie
Étudiante : Amélie Morin; collaboratrice : Virginie Durand (UPA)
Les pollinisateurs connaissent un déclin important depuis les dernières décennies. Un outil de conservation fréquemment utilisé est l’aménagement de bandes fleuries implantées en bordure de champs. Elles visent à fournir un habitat de qualité et des ressources alimentaires aux pollinisateurs. L’entretien de ces bandes, leur largeur et leur composition en espèces florales peuvent influencer la réponse des pollinisateurs à leur aménagement. L’objectif de ce projet est donc d’évaluer l’impact de la composition en espèces florales et de la largeur des bandes fleuries sur l’abondance et la richesse en espèces des populations de bourdons en Montérégie. Pour ce faire, des aménagements seront réalisés sur 24 fermes de grandes cultures de cette région. Différents mélanges de semences et différentes largeurs de bandes seront étudiés. Un inventaire mensuel des populations de bourdons sera effectué localement et à l’échelle de la ferme. Finalement, ce projet permettra de déterminer les caractéristiques que doivent posséder les bandes fleuries pour être des outils de conservation efficace pour les espèces de bourdons du Québec.
Étudiante : Amélie Morin; collaboratrice : Virginie Durand (UPA)
Les pollinisateurs connaissent un déclin important depuis les dernières décennies. Un outil de conservation fréquemment utilisé est l’aménagement de bandes fleuries implantées en bordure de champs. Elles visent à fournir un habitat de qualité et des ressources alimentaires aux pollinisateurs. L’entretien de ces bandes, leur largeur et leur composition en espèces florales peuvent influencer la réponse des pollinisateurs à leur aménagement. L’objectif de ce projet est donc d’évaluer l’impact de la composition en espèces florales et de la largeur des bandes fleuries sur l’abondance et la richesse en espèces des populations de bourdons en Montérégie. Pour ce faire, des aménagements seront réalisés sur 24 fermes de grandes cultures de cette région. Différents mélanges de semences et différentes largeurs de bandes seront étudiés. Un inventaire mensuel des populations de bourdons sera effectué localement et à l’échelle de la ferme. Finalement, ce projet permettra de déterminer les caractéristiques que doivent posséder les bandes fleuries pour être des outils de conservation efficace pour les espèces de bourdons du Québec.

Relation entre le butinage et la structure populationnelle du couvain et des ouvrières dans les colonies d’abeilles domestiques (Apis mellifera L.)
Étudiant en codirection : Kim Ménard; collaborateur : Pierre Giovenazzo (Université Laval)
Au Québec, l'abeille mellifère est l'espèce la plus utilisée dans le cadre des services de pollinisation du bleuet nain. La force des colonies est évaluée en nombre de cadres recouverts d’abeilles et le coût de location varie en fonction de cette évaluation. Cependant, puisqu’une proportion des abeilles évaluées sont des jeunes nourrices qui s’occupent du couvain et ne butinent pas à l’extérieur de la colonie, le nombre de butineuses ne suit pas une relation linéaire avec le nombre de cadres d’abeilles. En conséquence, une évaluation de la force uniquement basée sur le nombre de cadres recouverts d’abeilles, qui ne tient pas compte de la quantité de couvains et qui ne distingue pas les abeilles nourrices des abeilles butineuses n’est pas une représentation précise de la capacité de pollinisation d’une colonie. Cette étude a pour objectif de déterminer la structure optimale de couvain et de quantité d'abeilles dans une ruche pour à la fois favoriser la pollinisation et permettre aux apiculteurs d’optimiser leur gestion apicole. L'étude sera réalisée sur deux étés (2022-2023). Durant la première année, nous déterminerons la meilleure structure populationnelle pour optimiser le nombre de butineuse dans une colonie d’abeille. La deuxième année, nous testerons cette structure populationnelle dans des conditions de pollinisation du bleuet nain au Lac Saint-Jean. L’optimisation de la pollinisation résultant du projet augmentera les rendements et la qualité des fruits pour les producteurs et productrices de bleuets et donc leurs revenus. Les producteurs et productrices apicoles verront aussi leurs revenus augmentés par une augmentation de l’efficacité de la gestion de leurs colonies en relation avec une demande croissante en services de pollinisation.
Étudiant en codirection : Kim Ménard; collaborateur : Pierre Giovenazzo (Université Laval)
Au Québec, l'abeille mellifère est l'espèce la plus utilisée dans le cadre des services de pollinisation du bleuet nain. La force des colonies est évaluée en nombre de cadres recouverts d’abeilles et le coût de location varie en fonction de cette évaluation. Cependant, puisqu’une proportion des abeilles évaluées sont des jeunes nourrices qui s’occupent du couvain et ne butinent pas à l’extérieur de la colonie, le nombre de butineuses ne suit pas une relation linéaire avec le nombre de cadres d’abeilles. En conséquence, une évaluation de la force uniquement basée sur le nombre de cadres recouverts d’abeilles, qui ne tient pas compte de la quantité de couvains et qui ne distingue pas les abeilles nourrices des abeilles butineuses n’est pas une représentation précise de la capacité de pollinisation d’une colonie. Cette étude a pour objectif de déterminer la structure optimale de couvain et de quantité d'abeilles dans une ruche pour à la fois favoriser la pollinisation et permettre aux apiculteurs d’optimiser leur gestion apicole. L'étude sera réalisée sur deux étés (2022-2023). Durant la première année, nous déterminerons la meilleure structure populationnelle pour optimiser le nombre de butineuse dans une colonie d’abeille. La deuxième année, nous testerons cette structure populationnelle dans des conditions de pollinisation du bleuet nain au Lac Saint-Jean. L’optimisation de la pollinisation résultant du projet augmentera les rendements et la qualité des fruits pour les producteurs et productrices de bleuets et donc leurs revenus. Les producteurs et productrices apicoles verront aussi leurs revenus augmentés par une augmentation de l’efficacité de la gestion de leurs colonies en relation avec une demande croissante en services de pollinisation.

Suivi des populations d'altises dans les radis en sol organique et évaluation du piégeage de masse pour le contrôle des dommages
Étudiante : Laurence Fleury; collaboratrice : Anne-Marie Fortier (Compagnie de recherche Phytodata)
L’altise des crucifères (Phyllotreta crucifera) et l’altise du navet (Phyllotreta striolata) sont de grands ravageurs des cultures de crucifères. Les adultes se nourrissent des feuilles et la défoliation subséquente peut détruire entièrement les jeunes plants. La larve occasionne aussi des dommages aux crucifères racines en creusant des galeries pour se nourrir. Depuis quelques années, les dommages causés par les adultes et les larves ont pu être tels que certains champs de radis et radis chinois ont dû conséquemment être abandonnés. Aucune relation entre l’intensité des populations d’adulte et les dommages occasionnés par leurs larves n’a pu être établie jusqu’à maintenant. Le projet consistera donc dans un premier temps à vérifier l’existence d’une potentielle corrélation entre le dépistage et la capture par piège des adultes ainsi que du dépistage des dommages de larves. Dans un deuxième temps, l’efficacité de méthodes de contrôle des dommages sera évaluée, telles que le piégeage de masse et l’utilisation de filets d’exclusion en couverture et en clôture.
Étudiante : Laurence Fleury; collaboratrice : Anne-Marie Fortier (Compagnie de recherche Phytodata)
L’altise des crucifères (Phyllotreta crucifera) et l’altise du navet (Phyllotreta striolata) sont de grands ravageurs des cultures de crucifères. Les adultes se nourrissent des feuilles et la défoliation subséquente peut détruire entièrement les jeunes plants. La larve occasionne aussi des dommages aux crucifères racines en creusant des galeries pour se nourrir. Depuis quelques années, les dommages causés par les adultes et les larves ont pu être tels que certains champs de radis et radis chinois ont dû conséquemment être abandonnés. Aucune relation entre l’intensité des populations d’adulte et les dommages occasionnés par leurs larves n’a pu être établie jusqu’à maintenant. Le projet consistera donc dans un premier temps à vérifier l’existence d’une potentielle corrélation entre le dépistage et la capture par piège des adultes ainsi que du dépistage des dommages de larves. Dans un deuxième temps, l’efficacité de méthodes de contrôle des dommages sera évaluée, telles que le piégeage de masse et l’utilisation de filets d’exclusion en couverture et en clôture.

Optimisation de la pollinisation du bleuet nain par les abeilles domestiques et les bourdons
Étudiante : Ana María Quiroga Arcila; collaborateur : Pierre Giovenazzo (Université Laval)
Le Canada est le premier producteur mondial de bleuet nain (Vaccinium angustifolium) et le Québec en est la principale province productrice. La location de colonies d’abeilles domestiques est la principale source de services de pollinisation. Le coût de ce service augmente depuis les 20 dernières années et représente une dépense de plus de 4 M$ pour les producteurs et productrices de bleuets nains au Québec. Pourtant, les recommandations concernant les densités de ruche d’abeilles domestiques et de ruchettes de bourdons à utiliser dans le bleuet nain sont encore imprécises. Le but de cette recherche est d’optimiser les services de pollinisation du bleuet nain à partir de l’augmentation de la densité des colonies d’abeilles domestiques ainsi que de comparer l’efficacité de la pollinisation effectuée par les colonies d’abeilles domestiques et les colonies de bourdons. La recherche sera développée entièrement in situ dans neuf bleuetières typiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant quatre années consécutives à partir de l’été 2022. Cette étude permettra de développer un modèle afin d’estimer la densité optimale de colonies d’abeilles domestiques pour la pollinisation du bleuet nain en fonction du contexte cultural. Le modèle permettra aussi d’évaluer l’efficacité pollinisatrice des ruchettes de bourdons commerciaux.
Étudiante : Ana María Quiroga Arcila; collaborateur : Pierre Giovenazzo (Université Laval)
Le Canada est le premier producteur mondial de bleuet nain (Vaccinium angustifolium) et le Québec en est la principale province productrice. La location de colonies d’abeilles domestiques est la principale source de services de pollinisation. Le coût de ce service augmente depuis les 20 dernières années et représente une dépense de plus de 4 M$ pour les producteurs et productrices de bleuets nains au Québec. Pourtant, les recommandations concernant les densités de ruche d’abeilles domestiques et de ruchettes de bourdons à utiliser dans le bleuet nain sont encore imprécises. Le but de cette recherche est d’optimiser les services de pollinisation du bleuet nain à partir de l’augmentation de la densité des colonies d’abeilles domestiques ainsi que de comparer l’efficacité de la pollinisation effectuée par les colonies d’abeilles domestiques et les colonies de bourdons. La recherche sera développée entièrement in situ dans neuf bleuetières typiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant quatre années consécutives à partir de l’été 2022. Cette étude permettra de développer un modèle afin d’estimer la densité optimale de colonies d’abeilles domestiques pour la pollinisation du bleuet nain en fonction du contexte cultural. Le modèle permettra aussi d’évaluer l’efficacité pollinisatrice des ruchettes de bourdons commerciaux.

Identification de nouveaux signaux optiques des plantes pour la détection précoce des ravageurs du cannabis
Étudiant : Simon-Pierre Tchang; collaborateur : Xavier Maldague (Université Laval)
Le cannabis est une plante possédant une vaste gamme de ravageurs dont plusieurs insectes, maladies et champignons pouvant causer un stress allant parfois jusqu’aux pertes de rendement économique. Dans cette étude, nous déterminerons l’impact du stress sur le cannabis infligé par des organismes ravageurs tels que le thrips de l’oignon (Thrips tabaci (Lindeman)), le tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) et une espèce de puceron. Des observations seront faites à l’aide de caméras multispectrales afin d’offrir une description des symptômes optiques et visuels premiers du stress chez la plante selon le type de ravageurs. Ces résultats serviront à la création d’un algorithme d’apprentissage automatique permettant de corréler la présence d’un ravageur selon les signaux de stress de la plante avec un traitement approprié au niveau des risques économiques.
Étudiant : Simon-Pierre Tchang; collaborateur : Xavier Maldague (Université Laval)
Le cannabis est une plante possédant une vaste gamme de ravageurs dont plusieurs insectes, maladies et champignons pouvant causer un stress allant parfois jusqu’aux pertes de rendement économique. Dans cette étude, nous déterminerons l’impact du stress sur le cannabis infligé par des organismes ravageurs tels que le thrips de l’oignon (Thrips tabaci (Lindeman)), le tétranyque à deux points (Tetranychus urticae) et une espèce de puceron. Des observations seront faites à l’aide de caméras multispectrales afin d’offrir une description des symptômes optiques et visuels premiers du stress chez la plante selon le type de ravageurs. Ces résultats serviront à la création d’un algorithme d’apprentissage automatique permettant de corréler la présence d’un ravageur selon les signaux de stress de la plante avec un traitement approprié au niveau des risques économiques.
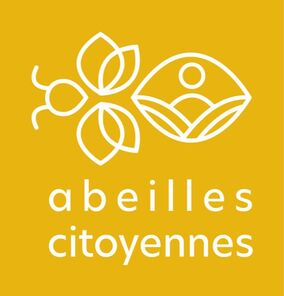
La science citoyenne comme outil pour étudier l'impact du paysage sur la biodiversité et la composition des communautés d'abeilles indigènes au Québec
Co-chercheuses principales : Sabrina Rondeau (University of Guelph/Université d'Ottawa) et Amélie Gervais; professionnel de recherche : Frédéric McCune
Abeilles citoyennes est un projet de science participative visant à inventorier la biodiversité des insectes pollinisateurs sauvages (abeilles et syrphes) à l’échelle du Québec. Dirigé par une équipe de recherche de l’Université Laval, le projet fait appel à l’aide du public pour collecter des données sur la distribution et l’abondance des espèces pollinisatrices dans les principales régions agricoles du Québec. Il vise à décrire et étudier leur diversité en fonction des caractéristiques du paysage.
Site web du projet : http://abeillescitoyennes.ca/
Co-chercheuses principales : Sabrina Rondeau (University of Guelph/Université d'Ottawa) et Amélie Gervais; professionnel de recherche : Frédéric McCune
Abeilles citoyennes est un projet de science participative visant à inventorier la biodiversité des insectes pollinisateurs sauvages (abeilles et syrphes) à l’échelle du Québec. Dirigé par une équipe de recherche de l’Université Laval, le projet fait appel à l’aide du public pour collecter des données sur la distribution et l’abondance des espèces pollinisatrices dans les principales régions agricoles du Québec. Il vise à décrire et étudier leur diversité en fonction des caractéristiques du paysage.
Site web du projet : http://abeillescitoyennes.ca/

Stratégies de lutte pour réduire l’impact phytosanitaire de la drosophile à ailes tachetées
Étudiante : Phanie Bonneau; collaboratrice : Annabelle Firleij (IRDA)
La drosophile à ailes tachetées, Drosophila suzukii Matsumura (Diptera : Drosophilidae), ou DAT, est un ravageur envahissant et est considérée comme une menace économique majeure des petits fruits en Amérique du Nord et en Europe. Contrairement aux autres drosophiles qui préfèrent les fruits en décomposition, la DAT cause des dommages aux fruits mûrs, juste avant leur récolte, les rendant non commercialisables. Au Québec, les cultures de framboises, fraises et bleuets sont les principales cultures touchées par la DAT depuis 2012. Les insecticides de synthèse sont actuellement le principal moyen de lutte utilisé contre ce ravageur. Cependant, les délais à respecter entre les applications répétées, les risques de résidus de pesticides sur les fruits et la rotation des produits disponibles ont créé un véritable casse-tête pour les producteurs québécois aux prises avec la DAT. Ce projet de recherche de doctorat a pour objectif de développer une stratégie de lutte biologique contre la DAT qui apportera une alternative prometteuse et durable pour les producteurs de petits fruits du Québec.
Étudiante : Phanie Bonneau; collaboratrice : Annabelle Firleij (IRDA)
La drosophile à ailes tachetées, Drosophila suzukii Matsumura (Diptera : Drosophilidae), ou DAT, est un ravageur envahissant et est considérée comme une menace économique majeure des petits fruits en Amérique du Nord et en Europe. Contrairement aux autres drosophiles qui préfèrent les fruits en décomposition, la DAT cause des dommages aux fruits mûrs, juste avant leur récolte, les rendant non commercialisables. Au Québec, les cultures de framboises, fraises et bleuets sont les principales cultures touchées par la DAT depuis 2012. Les insecticides de synthèse sont actuellement le principal moyen de lutte utilisé contre ce ravageur. Cependant, les délais à respecter entre les applications répétées, les risques de résidus de pesticides sur les fruits et la rotation des produits disponibles ont créé un véritable casse-tête pour les producteurs québécois aux prises avec la DAT. Ce projet de recherche de doctorat a pour objectif de développer une stratégie de lutte biologique contre la DAT qui apportera une alternative prometteuse et durable pour les producteurs de petits fruits du Québec.
Nos projets récemment terminés

Inventaire et étude du champignon entomopathogène du tarsonème du fraisier Hirsutella sp. afin de développer une stratégie de lutte biologique de conservation en production de fraises
Étudiante : Andréa Duclos; collaborateurs : Russel J. Tweddell (Université Laval), Joseph Moisan-De Serres (MAPAQ) et Stéphanie Tellier (MAPAQ)
Le tarsonème du fraisier est un ravageur important dans la culture de la fraise, car il occasionne des pertes de rendement élevées alors que les méthodes de lutte disponible contre cet acarien sont très peu nombreuses. Cependant, certains producteurs s’en tirent admirablement bien, alors qu’ils subissent de très faibles infestations de tarsonèmes tout en n’appliquant pas ou peu d’acaricides. Lors d’essais exploratoires réalisés en 2020 et 2021 afin d’investiguer ce phénomène, nous avons découvert, dans sept fraisières, des tarsonèmes naturellement mycosés par un champignon entomopathogène indigène. Le séquençage du champignon a révélé qu’il s’agissait d’un champignon du genre Hirsutella sp. Nous croyons que la présence de champignons entomopathogènes dans certains champs facilite le contrôle du tarsonème et que certaines pratiques à la ferme (régie de culture, intrants agricoles…) influencent la présence de ces champignons. Les objectifs de ce projet sont donc de déterminer la répartition d'Hirsutella dans les fraisières du Québec et d'identifier les facteurs affectant sa répartition, mais également de valider la pathogénicité du champignon contre le tarsonème.
Étudiante : Andréa Duclos; collaborateurs : Russel J. Tweddell (Université Laval), Joseph Moisan-De Serres (MAPAQ) et Stéphanie Tellier (MAPAQ)
Le tarsonème du fraisier est un ravageur important dans la culture de la fraise, car il occasionne des pertes de rendement élevées alors que les méthodes de lutte disponible contre cet acarien sont très peu nombreuses. Cependant, certains producteurs s’en tirent admirablement bien, alors qu’ils subissent de très faibles infestations de tarsonèmes tout en n’appliquant pas ou peu d’acaricides. Lors d’essais exploratoires réalisés en 2020 et 2021 afin d’investiguer ce phénomène, nous avons découvert, dans sept fraisières, des tarsonèmes naturellement mycosés par un champignon entomopathogène indigène. Le séquençage du champignon a révélé qu’il s’agissait d’un champignon du genre Hirsutella sp. Nous croyons que la présence de champignons entomopathogènes dans certains champs facilite le contrôle du tarsonème et que certaines pratiques à la ferme (régie de culture, intrants agricoles…) influencent la présence de ces champignons. Les objectifs de ce projet sont donc de déterminer la répartition d'Hirsutella dans les fraisières du Québec et d'identifier les facteurs affectant sa répartition, mais également de valider la pathogénicité du champignon contre le tarsonème.

Promouvoir la biodiversité des ennemis naturels en serre : évaluation de deux plantes réservoirs
Étudiante : Amélie Quesnel; collaboratrice : Geneviève Labrie (CRAM)
L’utilisation de plantes réservoirs en lutte biologique par conservation consiste en l’introduction d’une plante non cultivée offrant de multiples bénéfices pour les ennemis naturels et les auxiliaires de lutte biologique tels qu’un abri, de la nourriture et un site de ponte. Cette technique a pour but de soutenir les populations de prédateurs dans le paysage agricole menant ainsi à un meilleur potentiel de lutte biologique. Parmi ces plantes réservoirs, Lobularia maritima (Brassicales: Brassicaceae), soit l’alysson maritime, et le Calendula officinalis (Asterales: Asteraceae) sont d’excellents candidats, par leur période de floraison longue et leur bonne source de pollen et de nectar. Dans cette optique, durant les étés 2021 et 2022, ces plantes réservoirs ont été introduites dans un total de quatorze serres de poivrons et de concombres au Québec et un inventaire des ennemis naturels et auxiliaires de lutte biologique a été réalisé.
Étudiante : Amélie Quesnel; collaboratrice : Geneviève Labrie (CRAM)
L’utilisation de plantes réservoirs en lutte biologique par conservation consiste en l’introduction d’une plante non cultivée offrant de multiples bénéfices pour les ennemis naturels et les auxiliaires de lutte biologique tels qu’un abri, de la nourriture et un site de ponte. Cette technique a pour but de soutenir les populations de prédateurs dans le paysage agricole menant ainsi à un meilleur potentiel de lutte biologique. Parmi ces plantes réservoirs, Lobularia maritima (Brassicales: Brassicaceae), soit l’alysson maritime, et le Calendula officinalis (Asterales: Asteraceae) sont d’excellents candidats, par leur période de floraison longue et leur bonne source de pollen et de nectar. Dans cette optique, durant les étés 2021 et 2022, ces plantes réservoirs ont été introduites dans un total de quatorze serres de poivrons et de concombres au Québec et un inventaire des ennemis naturels et auxiliaires de lutte biologique a été réalisé.

Biologie de la tenthrède en zigzag de l’orme dans sa nouvelle aire de répartition au Québec et en Amérique du Nord
Étudiant : Julien Lafrenière; collaboratrice : Véronique Martel (Ressources naturelles Canada)
En août 2020, l’ACIA a confirmé la présence d’une nouvelle espèce exotique envahissante : la tenthrède en zigzag de l’orme, Aproceros leucopoda Takeuchi (Hymenoptera : Argidae). Sa présence a été signalée pour la première fois à Sainte-Martine, en Montérégie, mais a par la suite été recensée à travers le Québec. La tenthrède en zigzag de l’orme est une espèce multivoltine qui est endémique en Chine et au Japon. Aproceros leucopoda a été identifié pour une première fois en Europe en 2003 et, depuis, elle est présente dans presque tous les pays du continent. La tenthrède en zigzag de l’orme peut être un risque pour les populations d’ormes qui sont déjà ravagés par la maladie hollandaise de l’orme. Afin d’évaluer le risque que représente cette espèce au Québec et au Canada, et de développer une stratégie de gestion, il est important de connaître d’abord ses traits d’histoire de vie dans ce nouvel habitat. Les traits étudiés sont la saisonnalité, des caractères physionomiques et la caractérisation des ennemis naturels.
Étudiant : Julien Lafrenière; collaboratrice : Véronique Martel (Ressources naturelles Canada)
En août 2020, l’ACIA a confirmé la présence d’une nouvelle espèce exotique envahissante : la tenthrède en zigzag de l’orme, Aproceros leucopoda Takeuchi (Hymenoptera : Argidae). Sa présence a été signalée pour la première fois à Sainte-Martine, en Montérégie, mais a par la suite été recensée à travers le Québec. La tenthrède en zigzag de l’orme est une espèce multivoltine qui est endémique en Chine et au Japon. Aproceros leucopoda a été identifié pour une première fois en Europe en 2003 et, depuis, elle est présente dans presque tous les pays du continent. La tenthrède en zigzag de l’orme peut être un risque pour les populations d’ormes qui sont déjà ravagés par la maladie hollandaise de l’orme. Afin d’évaluer le risque que représente cette espèce au Québec et au Canada, et de développer une stratégie de gestion, il est important de connaître d’abord ses traits d’histoire de vie dans ce nouvel habitat. Les traits étudiés sont la saisonnalité, des caractères physionomiques et la caractérisation des ennemis naturels.

Phénologie et biologie de la mouche du bleuet dans le contexte du Lac-Saint-Jean
Professionnel de recherche : Frédéric McCune
La présence nouvellement répertoriée de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax) dans la culture de bleuets nains au Lac-Saint-Jean est préoccupante pour l’industrie et pourrait causer d’importantes pertes économiques. Pour adopter une stratégie de lutte intégrée contre ce nouveau ravageur, il s’avère d’abord primordial d’étudier sa biologie dans le contexte du Lac-Saint-Jean. Ce projet vise donc à étudier la phénologie de la mouche du bleuet dans les conditions météorologiques de la région, son utilisation des hôtes sauvages locales et sa présence dans les différents types d’habitats (naturels, en végétation et en production). Pour parvenir aux objectifs du projet, les fruits de plantes sauvages sont récoltés afin d’y déceler la présence de larves, un dispositif de piégeage est établi afin de suivre la présence de la mouche dans différents habitats tout au long de la saison et pour établir le moment de maturité sexuelle de l’insecte. Finalement, un modèle bioclimatique prévisionnel basé sur les cumuls thermiques (degrés-jours) sera adapté aux données locales.
Professionnel de recherche : Frédéric McCune
La présence nouvellement répertoriée de la mouche du bleuet (Rhagoletis mendax) dans la culture de bleuets nains au Lac-Saint-Jean est préoccupante pour l’industrie et pourrait causer d’importantes pertes économiques. Pour adopter une stratégie de lutte intégrée contre ce nouveau ravageur, il s’avère d’abord primordial d’étudier sa biologie dans le contexte du Lac-Saint-Jean. Ce projet vise donc à étudier la phénologie de la mouche du bleuet dans les conditions météorologiques de la région, son utilisation des hôtes sauvages locales et sa présence dans les différents types d’habitats (naturels, en végétation et en production). Pour parvenir aux objectifs du projet, les fruits de plantes sauvages sont récoltés afin d’y déceler la présence de larves, un dispositif de piégeage est établi afin de suivre la présence de la mouche dans différents habitats tout au long de la saison et pour établir le moment de maturité sexuelle de l’insecte. Finalement, un modèle bioclimatique prévisionnel basé sur les cumuls thermiques (degrés-jours) sera adapté aux données locales.

Élaboration d’une stratégie de lutte intégrée contre le ver-gris occidental du haricot (VGOH) dans la culture de maïs au Québec
Étudiante : Stéphanie Gervais; collaborateur : Julien Saguez (CÉROM)
Le ver-gris occidental du haricot (Striacosta albicosta) (VGOH) est un ravageur émergent au Québec. Les premières observations de cet insecte ravageur sur le territoire québécois remontent à 2009 et les premiers dommages économiques à 2016. Le VGOH s’attaque principalement aux différentes cultures de maïs, causant des pertes de rendements considérables tout en diminuant la qualité des grains par le développement potentiel de mycotoxines. Depuis 2010, le Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) Grandes culture réalise le suivie de sa population à l’aide de pièges à phéromones pour la capture des papillons et depuis quelques années un dépistage des masses d’œufs et des larves est réalisé. Comme la majorité des lépidoptères, il n’y a pas de corrélation entre la présence de papillons et de dommages, ce qui rend plus difficile la prédiction de la période de lutte. Ce projet vise à déterminer une stratégie de lutte intégrée avec un seuil d’intervention spécifique pour le Québec avec différentes approches dont : l’utilisation de maïs Bt, la présence d’ennemis naturels et l’utilisation d’insecticides à faible risque, afin d’effectuer une bonne gestion intégrée de ce ravageur et de limiter l’utilisation de pesticides tout en respectant la santé des producteurs et l’environnement.
Étudiante : Stéphanie Gervais; collaborateur : Julien Saguez (CÉROM)
Le ver-gris occidental du haricot (Striacosta albicosta) (VGOH) est un ravageur émergent au Québec. Les premières observations de cet insecte ravageur sur le territoire québécois remontent à 2009 et les premiers dommages économiques à 2016. Le VGOH s’attaque principalement aux différentes cultures de maïs, causant des pertes de rendements considérables tout en diminuant la qualité des grains par le développement potentiel de mycotoxines. Depuis 2010, le Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) Grandes culture réalise le suivie de sa population à l’aide de pièges à phéromones pour la capture des papillons et depuis quelques années un dépistage des masses d’œufs et des larves est réalisé. Comme la majorité des lépidoptères, il n’y a pas de corrélation entre la présence de papillons et de dommages, ce qui rend plus difficile la prédiction de la période de lutte. Ce projet vise à déterminer une stratégie de lutte intégrée avec un seuil d’intervention spécifique pour le Québec avec différentes approches dont : l’utilisation de maïs Bt, la présence d’ennemis naturels et l’utilisation d’insecticides à faible risque, afin d’effectuer une bonne gestion intégrée de ce ravageur et de limiter l’utilisation de pesticides tout en respectant la santé des producteurs et l’environnement.

Cultures de couverture pérennes sur le rang : influence sur l’entomofaune auxiliaire en viticulture biologique
Étudiante en codirection : Patricia Denis; chercheuse principale : Caroline Halde (Université Laval)
L’implantation de cultures de couverture pérennes sur le rang, bien que peu répandu au Québec, est une pratique utilisée en viticulture par les producteurs en régie biologique afin de compétitionner les adventices nuisibles, améliorer la santé des sols et attirer les insectes bénéfiques. Cependant, il n’existe pas d’études scientifiques ayant caractérisés les effets de cultures de couverture pérennes sur le rang dans des vignobles québécois. L’objectif de ce projet est donc de combler cette lacune en évaluant les effets des cultures de couverture pérennes sur l’écosystème sous la canopée des vignes. Les résultats de cette recherche révèleront si des cultures de couverture pérennes pourraient être efficaces pour promouvoir les insectes bénéfiques et la lutte contre les adventices en vignoble. Plus encore, s’il s’agira d’un outil de contrôle biologique pertinent et utilisable dans le but d’une agriculture durable.
Étudiante en codirection : Patricia Denis; chercheuse principale : Caroline Halde (Université Laval)
L’implantation de cultures de couverture pérennes sur le rang, bien que peu répandu au Québec, est une pratique utilisée en viticulture par les producteurs en régie biologique afin de compétitionner les adventices nuisibles, améliorer la santé des sols et attirer les insectes bénéfiques. Cependant, il n’existe pas d’études scientifiques ayant caractérisés les effets de cultures de couverture pérennes sur le rang dans des vignobles québécois. L’objectif de ce projet est donc de combler cette lacune en évaluant les effets des cultures de couverture pérennes sur l’écosystème sous la canopée des vignes. Les résultats de cette recherche révèleront si des cultures de couverture pérennes pourraient être efficaces pour promouvoir les insectes bénéfiques et la lutte contre les adventices en vignoble. Plus encore, s’il s’agira d’un outil de contrôle biologique pertinent et utilisable dans le but d’une agriculture durable.

Amélioration de la performance et de la résilience des écosystèmes urbains par la biodiversification des couvre-sols
Étudiante en codirection : Anaïs Grenier; chercheur principal : Guillaume Grégoire (Université Laval)
Les surfaces engazonnées, généralement composées de pâturin du Kentucky (Poa pratensis L.), sont omniprésentes en milieu urbain. Celles-ci constituent un écosystème simplifié à faible biodiversité végétale. En considérant leur importance spatiale, ces superficies présentent un grand potentiel d'amélioration de biodiversité pouvant augmenter leurs services écosystémiques. La recherche d'alternatives nécessitant moins d'entretien est aussi très intéressante pour les municipalités. Ainsi, ce projet porte sur l’introduction d’herbacées, leur résilience au piétinement et à travers une pelouse déjà établie tout en cherchant à favoriser l’attirance des pollinisateurs urbains. Il se déroule plus particulièrement dans des parcs de Québec et de Montréal.
Étudiante en codirection : Anaïs Grenier; chercheur principal : Guillaume Grégoire (Université Laval)
Les surfaces engazonnées, généralement composées de pâturin du Kentucky (Poa pratensis L.), sont omniprésentes en milieu urbain. Celles-ci constituent un écosystème simplifié à faible biodiversité végétale. En considérant leur importance spatiale, ces superficies présentent un grand potentiel d'amélioration de biodiversité pouvant augmenter leurs services écosystémiques. La recherche d'alternatives nécessitant moins d'entretien est aussi très intéressante pour les municipalités. Ainsi, ce projet porte sur l’introduction d’herbacées, leur résilience au piétinement et à travers une pelouse déjà établie tout en cherchant à favoriser l’attirance des pollinisateurs urbains. Il se déroule plus particulièrement dans des parcs de Québec et de Montréal.

Développement des connaissances sur les cicadelles dans la culture de la fraise et sur leur rôle en tant que vecteurs de maladies virales et bactériennes
Étudiant en codirection : Nicolas Plante; chercheur principal : Edel Pérez-López (Université Laval)
Les cicadelles sont de petits insectes qui s’attaquent à une multitude de plantes et cultures différentes. Au cours des dernières années, l'incidence des cicadelles dans les fraisières a considérablement augmenté en raison des changements climatiques. Ces petits homoptères causent de plus en plus de dommages préoccupants pour les producteurs de fraises du Québec. Les cicadelles causent des dommages aux plants lors de leur alimentation, mais ce sont également des insectes vecteurs de maladies bactériennes et virales comme les phytoplasmes. Actuellement, il n’y a pas beaucoup d’informations au sujet de l’inventaire des cicadelles présentes dans les fraisières au Québec et également sur leur rôle en tant que vectrices de phytoplasmes. Ainsi, les résultats de ce projet permettront d’acquérir des connaissances sur la diversité et l’abondance des cicadelles présentes dans les fraises et permettront également de savoir lesquelles sont vectrices de phytoplasmes. L’amélioration des connaissances permettra aussi d’optimiser le moment d’intervention dans les champs pour éviter les pertes de rendements et la surutilisation de pesticides pour lutter contre le ravageur.
Étudiant en codirection : Nicolas Plante; chercheur principal : Edel Pérez-López (Université Laval)
Les cicadelles sont de petits insectes qui s’attaquent à une multitude de plantes et cultures différentes. Au cours des dernières années, l'incidence des cicadelles dans les fraisières a considérablement augmenté en raison des changements climatiques. Ces petits homoptères causent de plus en plus de dommages préoccupants pour les producteurs de fraises du Québec. Les cicadelles causent des dommages aux plants lors de leur alimentation, mais ce sont également des insectes vecteurs de maladies bactériennes et virales comme les phytoplasmes. Actuellement, il n’y a pas beaucoup d’informations au sujet de l’inventaire des cicadelles présentes dans les fraisières au Québec et également sur leur rôle en tant que vectrices de phytoplasmes. Ainsi, les résultats de ce projet permettront d’acquérir des connaissances sur la diversité et l’abondance des cicadelles présentes dans les fraises et permettront également de savoir lesquelles sont vectrices de phytoplasmes. L’amélioration des connaissances permettra aussi d’optimiser le moment d’intervention dans les champs pour éviter les pertes de rendements et la surutilisation de pesticides pour lutter contre le ravageur.

Description du réseau trophique de la tordeuse des bourgeons de l’épinette
Étudiante : Valentine Glaus; collaboratrice : Véronique Martel (Ressources naturelles Canada)
Le but de l’étude est de comprendre les facteurs affectant les interactions entre les parasitoïdes de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) et leurs hôtes lépidoptères. Pour ce faire, un échantillonnage de chenilles et de parasitoïdes a été effectué au Québec en 2020 permettant de récolter plus de 2 000 chenilles. Un autre échantillonnage de plus de 700 chenilles a été réalisé au Nouveau-Brunswick en 2018 et 2019 dans des sites où la stratégie d’intervention hâtive (SIH) est appliquée. Ces données permettront de quantifier les interactions selon les facteurs suivants : niveau de population de la TBE, type de forêt, présence de perturbations et utilisation de la SIH contre la TBE. Les chenilles récoltées sont analysées par une approche moléculaire combinant les technologies TaqMan et qPCR afin de les identifier et de détecter les parasitoïdes. Ces données permettront de faire un portrait complet du réseau trophique de la TBE en fonction de l’habitat et du contexte et de mieux comprendre les interactions parasitoïdes – hôtes alternatifs.
Étudiante : Valentine Glaus; collaboratrice : Véronique Martel (Ressources naturelles Canada)
Le but de l’étude est de comprendre les facteurs affectant les interactions entre les parasitoïdes de la tordeuse des bourgeons de l'épinette (TBE) et leurs hôtes lépidoptères. Pour ce faire, un échantillonnage de chenilles et de parasitoïdes a été effectué au Québec en 2020 permettant de récolter plus de 2 000 chenilles. Un autre échantillonnage de plus de 700 chenilles a été réalisé au Nouveau-Brunswick en 2018 et 2019 dans des sites où la stratégie d’intervention hâtive (SIH) est appliquée. Ces données permettront de quantifier les interactions selon les facteurs suivants : niveau de population de la TBE, type de forêt, présence de perturbations et utilisation de la SIH contre la TBE. Les chenilles récoltées sont analysées par une approche moléculaire combinant les technologies TaqMan et qPCR afin de les identifier et de détecter les parasitoïdes. Ces données permettront de faire un portrait complet du réseau trophique de la TBE en fonction de l’habitat et du contexte et de mieux comprendre les interactions parasitoïdes – hôtes alternatifs.

Influence du climat et de la composition floristique sur la diversité des pollinisateurs dans les coupes forestières
Étudiante : Léonie Carignan-Guillemette; collaborateur : Mathieu Bouchard (MFFP / Université Laval)
De plus en plus d’études réalisées aux États-Unis et en Europe constatent un effet positif de la coupe totale sur les insectes polinisateurs. Au Québec, une grande variabilité climatique et environnementale est observable sur le territoire où est appliqué ce type de traitement sylvicole. Avec les changements climatiques, la capacité de soutien que présente cette perturbation anthropique pour nos populations indigènes de pollinisateurs forestiers soulève de nombreux questionnements. Notamment, quel est l’influence actuelle du gradient climatique et de la disponibilité de la ressource florale sur la diversité de syrphes et d’abeilles sauvages dans les coupes totales récentes au Québec ? Ce projet permettra aussi d’identifier quelles seront les espèces les plus vulnérables aux changements futurs selon leur répartition sur le territoire étudié. Étant une des premières études sur le sujet dans la province, ce projet constitut un apport entomologique considérable dans le domaine de la foresterie durable face aux changements climatiques.
Étudiante : Léonie Carignan-Guillemette; collaborateur : Mathieu Bouchard (MFFP / Université Laval)
De plus en plus d’études réalisées aux États-Unis et en Europe constatent un effet positif de la coupe totale sur les insectes polinisateurs. Au Québec, une grande variabilité climatique et environnementale est observable sur le territoire où est appliqué ce type de traitement sylvicole. Avec les changements climatiques, la capacité de soutien que présente cette perturbation anthropique pour nos populations indigènes de pollinisateurs forestiers soulève de nombreux questionnements. Notamment, quel est l’influence actuelle du gradient climatique et de la disponibilité de la ressource florale sur la diversité de syrphes et d’abeilles sauvages dans les coupes totales récentes au Québec ? Ce projet permettra aussi d’identifier quelles seront les espèces les plus vulnérables aux changements futurs selon leur répartition sur le territoire étudié. Étant une des premières études sur le sujet dans la province, ce projet constitut un apport entomologique considérable dans le domaine de la foresterie durable face aux changements climatiques.

